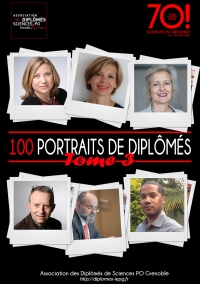Guy DU BOISBERRANGER (1968 SCPO), écrivain
 Peut-être notre cheminement professionnel est-il dû à
quelques dispositions personnelles, au hasard de l’existence qui
nous place à tel moment, en tels lieux, entre telles mains. Mais
dans mon cas une chose est sûre : Sciences Po m’a donné
la possibilité de tracer ce chemin en toute liberté.
Peut-être notre cheminement professionnel est-il dû à
quelques dispositions personnelles, au hasard de l’existence qui
nous place à tel moment, en tels lieux, entre telles mains. Mais
dans mon cas une chose est sûre : Sciences Po m’a donné
la possibilité de tracer ce chemin en toute liberté.
Je n’avais pas prévu de « faire »
Sciences PO. Après mon bac, le service militaire accompli, j’avais
juste négocié avec mon premier employeur une disponibilité
à mi-temps pour poursuivre mes études. Nommé à
Grenoble en août 1964, ignorant tout des cursus universitaires,
je m’étais inscrit, au hasard, à la faculté
de droit, place de Verdun.
J’y ai pris peur ! Les cours, délivrés par des mandarins
costumés à un bataillon de jeunes zombis, consistaient à
gratter sur papier un jargon juridique, à un rythme tel qu’il
était inutile d’essayer de le décrypter.
Je ne fus pas long à décrocher, d’autant plus que
l’UNEF local m’offrait une activité passionnante :
je fus chargé de gérer le ciné-club universitaire,
le théâtre universitaire et l’orchestre universitaire.
C’est là, à l’UNEF, qu’un camarade, lui-même
à Sciences PO, m’a convaincu d’y présenter ma
candidature.
C’était en face de la faculté de Droit, un vieux palais.
Jean Louis Quermone me reçoit : oui ! Le directeur en personne,
pour envisager « avec moi » mon futur dans l’établissement.
Ainsi, avant même d’apprendre la liberté, j’apprenais
la considération !
3 années pour un diplôme (en juin 1968 !), puis quelques
années encore pour un DES puis un doctorat (1972). Laissons de
côté, pour l’instant, mon recrutement concomitant dans
son centre de recherche. Pendant ces années de formation, qu’ai-je
appris qui me fut utile toute ma vie (en tout cas jusqu’à
ce jour) ?
Pour faire simple, j’ai appris à décider
de mon chemin. Quelle alchimie (plutôt quelle dialectique) y a présidé,
je ne sais pas trop, mais il se fait que j’ai appris là à
être sujet de ma vie professionnelle.
Déjà, les perspectives que m’offrait cet enseignement
étaient vastes. Inutile d’en faire ici l’inventaire
: un survol rapide des « portraits » des anciens élèves
donne un aperçu significatif des métiers possibles.
Mais je crois que ce ne fut pas cela le principal. Plutôt que de
m’apprendre un métier, on m’a appris à penser
et à décider de mon métier.
• On m’a appris que je n’avais pas besoin de m’agripper
au poste de travail qui m’est alloué.
• On m’a appris que le monde du travail est grand et que je
peux d’une certaine façon en disposer pour y vivre.
• On m’a appris à ne pas avoir peur de l’avenir
au point d’être victime de ma servilité.
Parlons concret.
On avait des vues sur moi : « Prépare-toi à l’ENA
». Je tâte : non, je ne veux pas être de cette caste.
« OK, regarde du côté de l’enseignement, en passant
par un doctorat puis l’agrégation » : Oui, la recherche
me plaît, j’adhère ; d’autant qu’on m’offre
un poste au CERAT. Je m’y donne à fond, j’explore les
théories de la science politique, je fusionne avec certaines d’elles
(le structuralisme marxiste, Poulanzas, ah ! Poulanzas). Je participe
activement aux études sur le pouvoir local. Mais je l’ai
dit : j’ai appris à penser et je comprends que pour moi,
manipuler à vie des concepts serait me couper dangereusement de
la réalité primaire des choses. Je démissionne alors
même que l’on m’offre, alléchante, ma titularisation
à la Fondation des Sciences politiques !
C’est de cela que je veux rendre compte. On m’a appris à
être libre !
Avec mon diplôme et mon expérience, il ne faut pas un mois
pour que l’on me propose, tout en haut de la France, un poste de
directeur des études sur l’environnement de cette région
dévastée. J’ai le droit à une équipe,
formidable, avec qui je vais ratisser le territoire pour rapporter aux
édiles publiques et privées, une analyse explosive des dégâts
qu’ils produisent.
Bien sûr, c’était me condamner à partir. Mais
j’avais pu agir en toute liberté.
Je reviens à Grenoble en janvier 1974. Je veux plonger plus avant
dans le substrat économique que je sais être l’infrastructure
de la société. Je peux avec ce que j’ai appris. Je
monte ma « petite entreprise », travail intense, peu rémunérateur,
mais riche d’enseignements fondamentaux. La photographie en est
l’objet, avec un laboratoire de façonnage qui irrigue tout
le marché du Sud-Est, une minichaîne locale « d’échoppes-photo
». C’est un succès. Le travail est professionnel. L’équipe,
hypermotivée, est efficace. L’entreprise grandit dans la
limite de ses fonds propres. Jusqu’à l’éruption
de la photo numérique, dans les années 95, qui la condamne
irrémédiablement.
Mais là encore, Sciences Po m’avait préparé
: grâce notamment à mon prof d’informatique à
l’IEP (c’était en 1967 !). Je savais la place que l’informatique,
sous toutes ses formes, allait prendre dans l’économie. Déjà,
pour ma thèse, j’avais utilisé l’analyse typologique
telle que déployée par IBM. Et notre « petite entreprise
» avait profité pour sa gestion d’une application «
maison » configurée par une équipe de « Math-appli
».
En 1998 la gestion informatisée en mode projet est en pleine expansion.
J’adhère à ce nouveau métier. Je m’essaye
dans une start-up : c’est très vite la cata. J’assume
l’échec.
J’ai alors 57 ans, juste « bon pour de l’intérim
» aux dires de l’APEC. C’est malgré tout l’APEC
qui m’oriente vers une formation de consultant SAP.
Et c’est une nouvelle « carrière » qui s’offre
à moi. Métier de rêve ! Je pénètre le
monde de la grande entreprise par la bonne porte et j’y découvre
toute l’énergie, toute l’intelligence, toute la rigueur
qui y sont déployées pour produire, distribuer, commercer.
Je suis amené à configurer et à manager cette révolution
qu’est le système d’information. Parallèlement,
je vais l’enseigner. Je prends la tête d’un centre de
formation qui va assurer la reconversion de centaines de cadres d’entreprises.
J’interviens également une année à IEP et plusieurs
à l’université de la Réunion pour présenter
cette voie aux étudiants.
Fallait-il vraiment que tout cela s’arrête ? À 70 ans
l’université me ferme ses portes (j’ai enseigné
une année de plus par dérogation). Dans le privé
il devient difficile, même en indépendant, de convaincre
la clientèle de la pérennité de mon aptitude. Suis-je
contraint à la retraite ?
Oui, en partie et je reconnais que cela a un certain charme : les randonnées,
les voyages, les petits-enfants… Mais pour l’autre partie
je deviens… écrivain. C’est ma liberté, une
fois encore acquise à l’IEP, par l’apprentissage de
l’écriture.
J’ai tout de suite en 2011 une opportunité exceptionnelle.
J’avais mené les deux années antérieures une
longue mission dans l’entreprise grenobloise, mais de dimension
mondiale : « A.Raymond Network ». J’y avais découvert
un gisement de pratiques socio-économiques qui méritait
d’être exploré. Je demande à sa direction l’autorisation
d’investiguer. Elle me donne carte blanche pour « résider
» dans l’entreprise, interviewer tous ses collaborateurs,
consulter toutes les archives, analyser les évènements.
Je décide de transcrire ce que j’ai observé et documenté.
La rédaction m’occupera deux ans. Il en sortira un livre
: « l’Industrialisation, mode d’emploi », publié
en 2012 chez l’Harmattan.
J’ai aimé écrire. Pourquoi ne pas poursuivre ?
Une chose m’avait particulièrement choqué tout au
long de ma carrière professionnelle : la financiarisation de l’économie
qui, de ce que j’avais vu, portait une forte responsabilité
dans la désindustrialisation. Je décidai d’aborder
ce sujet dans un nouveau livre. J’utilisai cette fois-ci la fiction
pour raconter la sombre histoire du sabordage d’une entreprise industrielle.
C’est devenu un thriller, « L’escalier de Marbre »,
publié en février de cette année.
Et puisque j’y avais pris goût, je persévère.
Je lance un nouveau chantier d’écriture. Ce sera encore un
thriller, l’histoire de…
Stop ! Le chantier est fermé au public.
Guy DU BOISBERRANGER
Afficher
son courriel