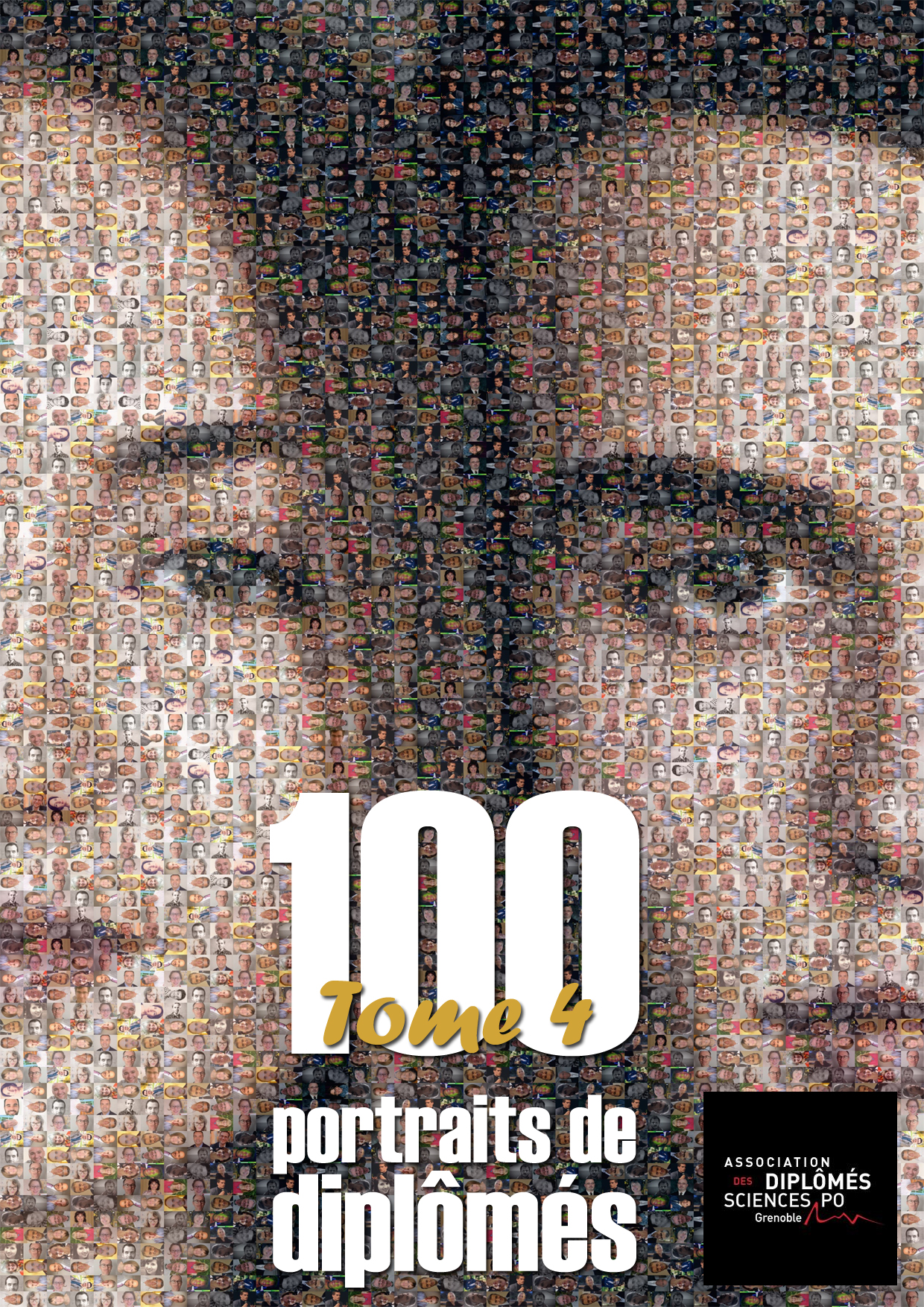Catherine RUMILLAT (1978 SP)
 L'appel
de notre Newsletter à publication de « portraits de femme » m'a interpellée
mais j'hésitais, redoutant peut-être ce difficile exercice de l'autoportrait.
J'ai résolu le dilemme en retenant la formule de l'entretien.
L'appel
de notre Newsletter à publication de « portraits de femme » m'a interpellée
mais j'hésitais, redoutant peut-être ce difficile exercice de l'autoportrait.
J'ai résolu le dilemme en retenant la formule de l'entretien.
Interview réalisée par Christiane RUMILLAT (1981 PS), soeur de Catherine RUMILLAT
Christiane (CR). En rentrant à sciences po, tu es passée, me disais-tu, d'un monde à l'autre. Quels sont les ressorts de ce passage ?
Rentrer à Sciences Po a été un acte d'émancipation majeur
dans les années 70. Jusqu'à mon BAC, j'étais une élève grenobloise sans
connexion sociale, sans culture internationale, sans conscience politique
particulière. Cette année-là, un job d'été m'a conduite vers un monde
social et culturel étranger au mien, propulsée dans la famille biculturelle
d'une femme d'affaires franco-américaine. Lorsqu'elle me demande ce que
je vais étudier à la rentrée, je réponds un BTS tourisme parce que je
parle quelques langues étrangères et que je veux voyager. Tout de go,
elle m'exhorte à m'inscrire à sciences po.
La nouvelle a été accueillie avec incrédulité par ma famille et j'avoue
que pour l'adolescente rebelle que j'étais, mon acte prenait un tour subversif
qui m'a stimulée. J'ai travaillé beaucoup, plus que d’autres étudiants
car l’échec n’était pas une option pour moi. Première année incroyable
où tout s’ouvrait. En suivant les cours, j'ai appris ce qu'était l'engagement.
On y parlait de l'apartheid, de révolution, de lutte pour la liberté d’expression,
de travail. Je trouvais ça passionnant tous ces pays qui se libéraient,
tous ces gens en mouvement, en colère, en souffrance, qui se battaient
pour conquérir le droit de vote, le droit de dénoncer, de parler, de vivre
tout simplement.
CR. Oubliés les voyages et les langues étrangères ?
Non, en parallèle à sciences po, je commence une maîtrise trilingue, anglais-allemand, et j’étudie d’autres langues. L'été, je continue à garder les enfants de riches industriels, de gens de la mode et de leurs amis artistes. J'évolue dans ce gratin et rend service un week-end à un ponte de la confection qui se trouvait sans assistante pour faire face à des journalistes européens. J'ai été catapultée dans le cœur d’un business où je captais l’essentiel, les enjeux mais où tous les détails m’échappaient ! A la fin de l'été, ce magnat de la confection me propose de venir travailler dans son entreprise une fois mon diplôme de sciences po en poche.
Je me retrouve à Paris, incertaine mais volontaire, premier job au salaire de misère, avec promesse que cela changerait. Responsable des collections d’un couturier américain, je découvre le travail harassant des femmes en usines à Hénin-Beaumont, à Valenciennes, dans le Nord froid et miséreux de l’époque. A côté je côtoie des stylistes, des personnages qui, lorsqu’ils viennent en France, logent au Plazza Athénée et se shootent aux cookies parfum cocaïne avant midi !
CR. Une autre version de ce « passage » d'un monde à un autre ?
Au bout d’un an dans ce milieu si exotique, je pars en claquant la porte. Suit une année de petits travaux manuels, de stages (toujours en rapport avec l’export et l’international) pour vivre et payer mon loyer. Jusqu'à ce que mon ange gardien (la business woman biculturelle de l'été du BAC) m’appelle pour m’informer d’un poste à la Direction Générale des Télécoms (DGT) qui dépendait du Ministère des PTT. Après deux ou trois entretiens, la responsable me donne la préférence sur d'autres candidates sortant de l’école des attachés de presse, très réputée à l’époque. En fait, nous avons eu une sorte de coup de foudre professionnel et personnel ! Elle privilégie les aptitudes relationnelles et me forme au métier. Un mois après mon arrivée, je me retrouve à Los Angeles pour une des plus grosses expositions internationales télécom de l’année.
CR. Pour quelqu'un qui espérait de l’action et de l’international, ça commençait très fort !
Oui et c'est une chance (un mot que j'emploie très souvent
paraît-il). Je suis entrée à la DGT à un moment où les enjeux étaient
monumentaux. Nous sommes dans les années 80. Ce sont les débuts du Minitel,
des centraux téléphoniques nouvelle génération, des premiers visiophones,
ancêtres des skype, whatsapp et autres messenger…
Je partais avec le ministre des PTT pour inaugurer des centraux téléphoniques
dans les pays où nous avions des contrats (Liban, Indonésie, Irlande...).
Oui à cette époque, le ministre accompagnait les industriels sinon les
Etats n'achetaient pas.
J'organisais les conférences de presse, participais aux expos internationales,
je préparais les interviews avec les journalistes, bref j'assurais une
sorte de coordination à grande échelle. Il faut dire qu'à cette époque,
tout le monde s'y intéressait. C'était un boom sans précédent.
CR. Les NTIC, le sujet est complexe et vaste. Ce n'était pas ta formation !
Mes atouts n'étaient évidemment pas sur ce terrain-là. J'avais les langues - fondamental - et une énergie folle. Mon socle d'expertise, je l'ai acquis sur le terrain, dans ce rôle de communication et de coordination. Cela dit, mon véritable amour était ailleurs. Vivre à l'étranger restait mon projet, même au cœur de l'action à France Télécom. Et d'ailleurs, pour ne pas le perdre de vue et puisque j'étais sur Paris, j'ai préparé et passé un Master de relations internationales à la Sorbonne en 1984. J'ai eu des enseignants prestigieux et passionnants : Jean-Pierre Cot, ministre de la Coopération qui venait de démissionner car en désaccord avec la politique africaine du gouvernement Mauroy, Hélène Carrère-d’Encausse, maintenant à l’Académie Française, Jean-Luc Domenach, spécialiste de la Chine et bien d'autres. Je travaillais à France Télécom la journée et j’étudiais le soir, les week-ends et les vacances. Un plaisir inouï !
CR. Si je comprends bien, tu as travaillé 6 ans dans cette Direction mais il manquait quelque chose à ton goût de l'ailleurs : une vue de l'intérieur. Vivre, t'immerger dans un pays étranger. A partir de là commence vraiment, selon toi, ta carrière de manager international. Ton parcours est monumental. Dans l'ordre : Afrique de l'ouest, Moyen Orient, Afrique centrale, Caraïbes, Pacifique, Amérique Latine. Une passion : le management.
Ma carrière internationale est en effet partie d'une impulsion qui s'est transformée en choix de vie, non professionnel au départ. Nous sommes en 1986, je pars au Mali. Pendant un an, je travaille pour trois francs six sous dans une ONG dont le but était de sédentariser des nomades Touaregs. Absurde, avec le recul, on ne sédentarise pas des Nomades ! Je vis « à la malienne » ce qui me va bien, mais ne satisfait pas mon désir de challenge professionnel. A force de persévérance et d’appuis au Mali, je suis mandatée par l'éducation nationale sur un projet pédagogique que j'ai déployé avec une dizaine d'enseignants maliens. Sept ans de travail, six livres écrits. C'était de la gestion de projet, à petite échelle certes, mais qui m'a fait toucher à l'essentiel. Je travaillais avec une équipe de profs souvent pas payés, qui avaient, comme on dit là-bas « du mal à mettre de la viande dans le riz », et qu'il fallait coordonner, évaluer, motiver, tandis que moi, j'étais bien à l'abri avec mon salaire. Cette expérience fut l'antichambre de ma passion pour le management et aussi un apprentissage de l'humilité.
CR. Antichambre veut dire que tu n'es pas encore tombée dans le chaudron ?
Exact. Après ça, back to France et à France Télécom au cœur d'un autre challenge : passer d'entreprise publique à semi publique avec un mode de gestion privée. On m'a confié le coaching des directeurs régionaux et directeurs d'agence. Dans cette période, j'ai bénéficié d'une formation au coaching de deux ans chez des must du moment (Krauthammer, Bossard). Coaching, transformation, les ingrédients sont là : je comprends intuitivement que j’ai envie de manager des hommes et des femmes, monter des stratégies d'entreprise, organiser des services, déployer la technologie, développer les compétences, recruter et gérer de grosses équipes, innover...
CR. Il faut avoir une confiance et un sentiment de puissance importants pour se dire ça ?
Pas du tout. J'étais morte de trouille. Peur de ne pas être à la hauteur de la nouveauté, doutant de mes capacités. Mais la peur de l'échec chez moi est plus forte. Alors voilà, ma première expérience de management à l'international, la plus conséquente aussi, c'est en Egypte. J'ai d'abord monté et développé un centre d’appels puis dirigé le service clients (900 personnes) qui, grâce à mon équipe, deviendra la vitrine technologique et sociale du Moyen Orient.
Le contexte d’une start-up qui a acheté un opérateur historique est très particulier. Il s'agit de manager un énorme projet qui dépend d’hommes et de femmes aux compétences variées. Il faut ménager les susceptibilités des fonctionnaires égyptiens issus de cet opérateur poussiéreux, les intégrer et leur apprendre à travailler en mode start-up. Il a fallu acheter la technologie, recruter des gens, les former. J'ai travaillé avec une centaine de nationalités différentes (en anglais), consultants de tous les pays. Au début, pas de locaux, on faisait tout à l'hôtel. A savoir que lorsqu’on part dans un pays, Orange vous met à l’hôtel pour pouvoir prendre son poste dès le lendemain de votre arrivée. Ensuite, vous cherchez un logement avec le budget attribué, vous mettez les enfants à l’école française etc…
CR. On a du mal à croire que la peur de l'échec soit un moteur suffisant !
Il y en a un autre bien sûr : apprendre et avancer avec les autres. Et plus on le fait, plus on a envie de faire des choses nouvelles. Et puis il y a les résultats, la réussite. Je n'ai aucun complexe par rapport à ce mot. Les deux dernières années de mon travail en Egypte, les ministres et directeurs des opérateurs des pays comme Oman, Arabie Saoudite, Soudan, Emirats venaient visiter notre opération et écouter notre expérience en matière de technologie et de ressources humaines.
CR. J'aimerais que tu illustres ton expérience de management dans des eaux réputées troubles du point de vue politique. La Guinée équatoriale, le Nigéria ?
C'était la première fois qu'une femme était directeur général à Orange et en particulier sur ce territoire de langue espagnol, la Guinée Equatoriale, l’un des pays réputés les plus corrompus au monde. Ce n'est pas l'expérience la plus gratifiante, mais c'est la plus marquante. Ma feuille de route était de « faire le ménage », c’est-à-dire redresser l’entreprise qui perdait 30% de son chiffre d’affaires à cause de malversations internes. Pour faire évoluer la technologie, il fallait licencier des gens payés qui ne travaillaient pas et recruter des experts. Ceci dans un contexte politique très délicat, une dictature corrompue où l'entreprise appartient aux politiques. C'est un contexte de non-coopération absolue. La première chose que les gens font, c'est me décrédibiliser, parce que je suis une empêcheuse de « corrompre en rond ». Là-bas, Orange, même actionnaire minoritaire, était une rente : des centaines de personnes, employés ou ministres, vivent sur la bête, considérant que l'argent de l'entreprise est le leur.
CR. Comment motiver les gens à travailler dans ton sens alors ?
Pardon pour le caractère pompeux des mots que je vais employer, mais je pense qu'il faut arriver là-bas - à l'étranger d'une manière générale - avec deux choses : de la force et de l'humilité. Qu'il s'agisse des politiques, des personnes managées, de la population, il ne faut pas arriver en conquérant. Ça peut paraître évident, mais imagine : je suis une femme, bien sapée, j'ai un bon salaire, un appartement confortable, une voiture avec chauffeur...toute la panoplie pour se faire massacrer. Pour pouvoir travailler, il faut obtenir le respect. Et c'est là que mes deux mots ronflants ont du sens. Humilité veut dire se mettre dans une démarche d'apprentissage, écouter, observer quels sont les codes, les pensées, les comportements. Il faut aussi une force mentale adossée à une compétence et que celles-ci soient visibles et audibles. Indispensable mais non suffisant toutefois. Il faut trouver des alliés. Tout est en relation avec les politiques pour obtenir des autorisations, il faut donc s'appuyer sur des gens qui comprennent les enjeux. En Guinée Equatoriale, j'ai bien sûr trouvé du soutien auprès de mes correspondants du siège parisien d'Orange et, sur place, de l’ambassadeur de France. Mes collègues directeurs de Total, Air France, Bouygues... m’ont bien aidée moralement.
CR. Comment es-tu ressortie de cette expérience ?
Avec un sentiment majeur de précarité existentielle, car il fallait faire face à des situations non éthiques. Un directeur général à l'étranger est aussi responsable pénalement de tous ses employés. C'est un contexte angoissant. Nous avions des procès sur le dos. J'ai voulu mettre en place des organisations, des méthodes, surveiller le budget, les ressources humaines. J'ai avancé par petites victoires, souvent plus proches du combat que de la négociation. Mais il y a toujours eu du « je peux y arriver ». Et surtout il y a les autres. Je n'ai jamais lâché les gens avec qui je travaillais, je me sentais responsable d'eux.
CR. Il y a un devoir de protection dans le management ?
Absolument. Comme manager, je suis responsable d’une équipe, d’hommes et de femmes. Je me suis toujours considérée comme leur guide et leur soutien. Mes équipes savent que je me démène pour qu’elles puissent travailler dans de bonnes conditions avec les outils nécessaires. J’allais défendre nos plans de relance, notre stratégie, aussi bien dans les conseils d’administration que dans les réunions avec les finances ou les techniques.
CR. Je reviens sur ces pays où il t'a été difficile de travailler parce que difficile d'y vivre, voire d'y survivre, où on est dans l'en-deçà de la précarité existentielle que tu évoquais tout à l'heure. Quelle a été ton expérience au Nigéria ?
Cela faisait cinq ans que j’étais en Egypte, le service clients était en rythme de croisière, j’avais envie d’un nouveau challenge. Mes collègues indiens, des professionnels brillants, m’ont demandé de les accompagner sur une start-up au Nigéria. J’ai d'abord refusé car le Nigéria était et est toujours un pays très peu fréquentable. Après plusieurs aller/retour Le Caire-Londres pour rencontrer le propriétaire et les futurs membres du comité exécutif de cette start-up, j’accepte d’aller trois jours à Lagos… pour voir. Mon besoin de changement a été plus fort que mes craintes et deux mois après, j’étais recrutée pour créer « from scratch » le service clients de cet opérateur qui deviendra quelques années plus tard, un des plus gros d’Afrique.
Ce pays était angoissant, le propriétaire s’est avéré être un tyran. Les comités exécutifs ont vite pris une tournure qui ne laissait aucune place à la discussion. J’ai quand même commencé à planifier un centre d’appel de 8000 M2, à créer les design des agences physiques à Lagos, Abuja et Port Harcourt et commencé le recrutement de quelques experts.
La vie était bien trop dangereuse dans ce pays de non droit où les corps se comptaient par dizaines le long du lagon le matin. J’étais obligée de me cacher sous la plage arrière d’un véhicule pour aller à l’aéroport. La goutte qui a fait déborder le vase a été le meurtre d’une française dans son appartement alors que son compagnon faisait des courses. Puis l’enlèvement d’un autre Français responsable d’un grand laboratoire pharmaceutique que l’on a retrouvé dépouillé, en slip sur un pont, terrorisé mais heureusement en vie.
CR. Tu disais que tu as été la première femme directeur général pour Orange à l'étranger. Si on récapitule : femme, manager, en pays musulman, dans des environnements masculins, où la décision appartient aux hommes... Faut-il avoir un ADN masculin pour faire ce métier ?
Beaucoup m'ont renvoyé cette question du genre dans le métier. Intimement, c'est un non-sujet pour moi. Je n'y suis pas allée en intériorisant ma féminitude comme un handicap. Je ne me suis jamais dit, Catherine tu es une femme, il va falloir que tu fasses attention. En revanche je peux dire ce que j'ai dû faire et ce que j'ai pu faire parce que je suis une femme. D'abord, il m'a fallu travailler beaucoup plus qu'un homme pour gagner le respect, dans des pays très « viriles » comme l'Egypte, la République Dominicaine, le Brésil,... La botte secrète est banale : il faut montrer ses compétences, avoir du résultat.
Ensuite, être une femme m'a été utile pour recruter des
femmes. J’ai toujours eu à cœur d’aider les femmes dans des pays où elles
sont généralement peu représentées sur des postes à responsabilités. J’ai
commencé en Egypte où il y avait beaucoup à faire en matière d’acceptation
de superviseures et managers féminines puis en République Dominicaine
où la majorité de mon comité de direction était féminine. Mes assistantes,
dans tous les pays où j’ai travaillé, sont parties sur des postes de chef
de projet, responsable de com etc…Ces femmes ont pris confiance en elles,
elles ont osé franchir le pas malgré la position dans laquelle on les
enfermait.
Pour autant, il y a une chose qui ne fait pas oublier qu'on est une femme,
c'est le salaire : à niveau égal, j'ai toujours été moins bien payée que
mes collègues masculins !
CR. Partout où tu es allée, tu as pratiqué un management de proximité. Cela paraît difficile à imaginer dans des contextes où la distance entre la direction et ses employés est de mise. Comment t'y es-tu prise ?
J’ai toujours tissé des liens au-delà du professionnel car ces pays s’y prêtent. Je suis invitée aux mariages, aux baptêmes, aux fêtes musulmanes ou chrétiennes selon les pays, je vais danser avec mes équipes le week-end en République Dominicaine, j’apprends leur langue lorsque je ne la connais pas déjà : l’arabe, pendant 3 ans en Egypte, un peu de bislama au Vanuatu - bien que le pays parle anglais et français - le portugais à 59 ans au Brésil... Très utile d'ailleurs maintenant que je vis au Portugal !
J’organisais des journées « motivation/résultats/objectifs » avec mes équipes, à la mer où dans un lieu de villégiature. Les directeurs venaient avec leur famille. L'emplacement de mon bureau traduit assez bien la relation de travail que je voulais induire. Au Caire et à Saint Domingue, au lieu d'être perchée au dernier étage des « executives », mon bureau, en verre, était au milieu du centre d'appel. La porte était toujours ouverte, je pouvais les entendre travailler. Je voulais leur montrer que je travaillais avec eux et que j'étais là pour les aider. J'étais visible, les agents me connaissaient.
CR. Si je comprends bien, tu as gentiment bousculé les codes en donnant de ta personne : visibilité, écoute, proximité, partage, reconnaissance... C'est un management nourricier et empathique. J'imagine que tous ne succombaient pas. As-tu rencontré des résistances ?
C'est justement ce que je recherchais : des gens capables de résister. Comme je le disais plus haut, j'ai beaucoup recruté. Des managers d'abord, puisqu'ils devaient travailler en direct avec moi. Comment m'assurer qu'un candidat intégrera puis appliquera des méthodes différentes de la relation commandement-obéissance qu'il a lui-même connue ? Comment m'assurer qu'il prendra des initiatives s'il a été éduqué et valorisé sur ce mode-là ? Sera-t-il capable de me dire non ? Car, n'étant moi-même ni Egyptienne, ni Dominicaine, ni Brésilienne, j'ai besoin que mes managers m'aident à comprendre leurs codes dans le monde de l'entreprise. Ils doivent être capables de me dire : Catherine, ici, on ne peut pas faire ça, pas comme ça... Je ne voulais pas recruter des managers qui disent amen à ce que je dis, mais des alliés.

Ambrym Forest Vanuatu
CR. Comment faisais-tu la différence ?
Certains candidats arrivaient devant moi, femme et étrangère, avec une attitude arrogante, m'en mettaient plein la tête, j'ai fait ci, j'ai fait ça, faisant la roue, montrant une posture de pouvoir qu'ils estimaient adaptée à ce poste. Ils ne voient pas ce que manager suppose : s'oublier, faire passer l'équipe avant. Il faut dire que le mot manager dans bien des pays, c'est un must, synonyme d'emprise et d'influence. Il signifie que tu as atteint le summum. Là il faut les faire descendre de leur nuage, les faire adhérer à des pratiques participatives, introduire la question de l'évaluation qui n'existe pas car considérée comme une offense faite au manager.
CR. La dimension culturelle du management semble très intuitive. Est-ce qu'elle peut s'apprendre ?
Je n'applique pas de théorie. J’avais vécu huit ans dans un pays africain à 90% musulman et dû gérer des situations complexes. Arrivée en Egypte, j’avais les réflexes qui conviennent à ce type de société et la connaissance des codes : codes vestimentaires, codes de prise de parole, respect des pratiques religieuses...
CR. Est-ce suffisant ? On imagine qu'il n'est pas facile de concilier les codes culturels et les pratiques religieuses de ces pays avec les méthodes de travail d'une start-up !
Ce n'est pas si compliqué. Pas besoin d'aller jusqu'à
épouser les pratiques sociales et religieuses. Pendant le Ramadan, les
horaires étaient aménagés, on offrait le repas du soir au personnel travaillant
la nuit et on mettait des navettes à disposition entre leur lieu de travail
et leur domicile. Moi-même je ne mangeais pas ni ne buvais devant eux
pendant cette période.
On peut aussi faire adhérer à de nouvelles pratiques si elles sont bien
expliquées et justifiées du point de vue de l'entreprise. Par exemple
la tenue vestimentaire. Il fallait mettre les agents dans les conditions
d'exigence de la relation client. Faire passer la notion de soin de soi
en signe de respect de l'autre sur le lieu de travail n'allait pas de
soi. Sur ce point aussi l'exemplarité est importante : j'imposais pantalon,
chaussures, chemise ou chemisier propre, coiffure correcte, et moi-même
je portais des jupes au-dessous du genou, des manches longues ou mi- longues.
CR. Au début de cet entretien, tu disais que tu avais eu de la « chance » dans ta vie professionnelle. C'est une idée qui contraste avec la détermination que tu as mise dans ce que tu as réalisé.
Ce n'est pas de la fausse modestie. J'ai eu la chance, je confirme, d’avoir vécu plusieurs révolutions technologiques majeures : celle des centraux téléphoniques, du Minitel, des visiophones... j'en ai parlé au début. Puis celle de la téléphonie mobile - 2G, 3G et 4G -, celle des satellites de communication et celle du monde digital. J’ai connu la révolution de la fibre optique qui a permis la transmission de données, images, vidéos…, les fameux cheveux de lumière, comme on a pu les appeler, transportés par voie terrestre ou par des câbles déposés au fond des mers. Un navire câblier c'est d'ailleurs très impressionnant à visiter !
CR. Tu évoques à demi-mot un territoire hors continent, le Vanuatu, un archipel de plus de 80 îles en plein cœur du Pacifique, très loin des cultures côtoyées jusque-là. L'image qui vient spontanément, c'est celle du paradis...
En effet, après la Guinée équatoriale, le Vanuatu était un cadeau. J’ai adoré vivre dans ce pays où les gens sont gentils, ouverts, tout sourire mais qui ne savent pas dire non, je ne sais pas, je ne peux pas. Cette mission était pour moi : un désert technologique et un éloignement géographique qui me garantissait une autonomie importante. Nous sommes en 2011, il n'y a pas de 3G c'est à dire pas d’internet sur les mobiles, juste de la communication mobile voix et des connexions câbles en cuivre. L’entreprise perdait de l’argent. Pour éviter de mettre la clef sous la porte et permettre de revendre dans de bonnes conditions, Orange m’a donné trois ans. J’ai dû mettre en place un plan social, donc licencier et en même temps recruter les bons profils.

CR. J'imagine que les compétences télécoms n'étaient pas faciles à trouver dans ces contrées ?
Effectivement elles étaient rares et j’ai dû attirer des étrangers mais pas trop, car je devais respecter le quota imposé par le gouvernement Ni-Vanuatu. Je dis attirer parce que peu d’Européens souhaitent s’exiler en plein Pacifique, sur des îles volcaniques, coupées de tout, en proie aux tremblements de terre quotidiens, aux cyclones, à quatre heures de vol du continent australien et trente-six heures de Paris. Alors j'ai fait venir des collègues de Guinée équatoriale, d’Egypte, de France, de Suède et de Pologne. Les autres nationalités, Anglais, Australiens, Néo-Zélandais, vivaient au Vanuatu. J'ai eu recours aux VIE aussi (volontariat international en entreprise), tous de jeunes Français prêts à vivre une aventure professionnelle et personnelle unique au bout de la terre. Certains y sont restés d’ailleurs, d’autres sont revenus...avec la deuxième chaussure à leur pied. Ce paradis, comme tu disais, est propice aux idylles !
CR. En fin de compte, tu t'es appuyée sur ton propre réseau ?
Comme je l'ai dit, j'avais peu de temps pour remonter l’entreprise qui prenait l'eau puis la revendre dans des conditions acceptables. Donc oui le réseau est confortable, mais ce n'est pas juste de la facilité. J’ai souvent fait appel aux compétences de collaborateurs côtoyés ou managés dans différents pays. Certains se trouvaient en situation difficile dans leur pays, sans travail après des événements politiques ayant détruit l’économie de leur pays. D’autres étaient sans travail pour des raisons personnelles, heureux de pouvoir s'investir à fond pendant un ou deux ans. D'autres enfin, des ingénieurs d'Orange de Guinée équatoriale, coincés professionnellement, ont pu monter en compétences au Vanuatu. En les recrutant, tous, je n'avais aucun doute sur leur fiabilité et leur solidité. Pour eux c'était une super chance, pour moi c'était l'alliance du plaisir de partager une nouvelle expérience avec eux et la certitude que nous ferions du travail efficace. La notion de réseau pour moi a une dimension plus que concrète.
CR. Faisons un flashback sur les Ni-Vanuatu,
ces habitants du Vanuatu, que tu devais soit garder soit remplacer dans
l'entreprise.
Imagine, ces Nouvelles Hébrides découvertes par James Cook en 1774 deviennent
indépendantes en 1980. Trente ans auparavant, on y pratiquait encore le
cannibalisme guerrier. Trente ans après arrive la 3 G. Beaucoup de Ni-Vanuatu
étaient volontaires pour venir travailler dans la capitale Port Vila et
rejoindre le prestigieux domaine des télécoms. Mais ils pouvaient tout
aussi bien retourner sur leur île, dans leur village pour y vivre tranquillement
si ça ne marchait pas dans l’entreprise. En effet la pression professionnelle
ne fait pas partie de leur culture. Avec notre équipe de direction, nous
avons créé la notion de « grande famille » de 150 âmes. Concrètement,
j'ai fait, plus qu'ailleurs, du participatif : des réunions régulières
et fréquentes au cours desquelles tous, directeurs, managers, team leaders,
superviseurs, étaient conviés à élaborer les plans d'actions.
Au bout de deux ans et demi, après plusieurs changements d’actionnaires,
nous avons vendu l'entreprise correctement en gardant tous les employés
ni-vanuatu. Nous avions la 3G et grâce au câble sous-marin, nous pouvions
nous enorgueillir d'avoir désenclavé l’archipel.
CR. Quel a été le mode opératoire dominant là-bas : négociation, diplomatie, combat... pour reprendre quelques-uns des termes que tu as utilisés plus haut ?
Clairement la négociation et la diplomatie. Rien à voir avec la Guinée équatoriale ou le Nigéria !

CR. Tu parlais de cadeau plus haut, est-ce qu'il t'a été difficile de quitter le Vanuatu ?
Je garde un souvenir très tendre de ce territoire que j'ai sillonné d'île en île, pour inaugurer des antennes par exemple. Faute d'hôtels on dormait sur des nattes, faute de routes on traversait des lagons pour rejoindre l'aérodrome. On était accueilli dans les villages par des locaux en cache-sexe et tutu en feuilles de bananiers soufflant dans des codycross (coquillage servant d'instrument de musique). Les Ni-Vanuatu nous accueillaient avec ce qu’ils avaient et bien sûr le cava, boisson locale incontournable. Donc oui, difficile.
Quand je quitte Port-Vila, j'ai presque 58 ans. Je dois rentrer à Paris et, pour des raisons administratives, y rester deux ans avant de pouvoir espérer repartir. Hors de question. Bien sûr je ne suis pas prisonnière, je peux répondre à des offres d'autres opérateurs. Mais je ne suis pas en mesure de prendre une telle décision : je traverse pour la première fois de ma vie un épisode dépressif que je n'ai identifié que longtemps après.
CR. Est-ce à dire que tu as dû faire un break dans cette vie professionnelle nomade ?
Je me retrouve dans un bureau à Paris dans une tour, directrice des achats pour l’Afrique et le Moyen Orient. Je devais utiliser mes relations privilégiées avec les directeurs de ces pays pour que leurs responsables achats travaillent en toute transparence avec le siège parisien. C’était un management à la fois matriciel dans ces pays et direct sur mon équipe parisienne. Pendant cette période, je me démène pour repartir, exploitant mon réseau ici et ailleurs, négociant âprement les conditions (autonomie, ressources, moyens...). Je sais que ce sera ma dernière mission. Je la veux belle, solide, stimulante. Au bout d’un an et quelques mois, on me propose la direction de notre filiale arménienne, encore une opération dure et à risque. Puis enfin Rio De Janeiro, l'Amérique Latine !
CR. Le Graal donc ! De quel point de vue ?
Cette mission m'offrait l'opportunité d'une heureuse synthèse de mes compétences managériales : management direct, de proximité, matriciel et à distance. Il s'agissait de reconstituer un esprit d’équipe entre les directeurs des pays d’Amérique Latine pour qu’ils travaillent ensemble et non en opposition. Quant à l'objectif financier, il s'agissait de remonter le chiffre d’affaires global de l’Amérique Latine et passer le relais à une équipe soudée. Last but not least, il fallait développer la collaboration avec les différentes entités dans le monde puisque nous étions tous interdépendants : nos clients étaient de grandes multinationales qui comptaient sur nous pour leur réseau international et leur digitalisation.
CR. C'est un dimensionnement très différent de ce que tu avais connu jusque-là.
Totalement, aussi bien en termes de ressources humaines (des ingénieurs commerciaux) que géographique (cinq pays : Mexique, Colombie, Chili, Argentine, Brésil). Mais je l'ai voulu et négocié très lucidement : en bref, mon prédécesseur gérait seulement le Brésil et les autres pays rapportaient aux US. Ma vision en revanche était celle d’un continent si nous voulions sortir des mauvais résultats de chaque pays. C’est pourquoi j’avais demandé la totale, le Brésil seul ne permettrait pas de redonner une dynamique à l’entreprise.
CR. L'ultime challenge avant la retraite ?
Peut-être. Car avec le recul, ce n'était pas gagné. Les débuts ont été difficiles : j'avais été choisie par les big bosses d’Orange Business Services à Paris et surtout je n’étais moi-même pas ingénieure. Qu’est-ce qu’on nous envoie ? Une femme qui n’est pas ingénieure, dont le cœur de métier n’est pas la vente et qui en plus va diriger nos cinq pays d’Amérique Latine !
Au bout de quelques mois, je les ai embarqués dans le train de la transformation, dans un travail acharné pour reprendre pieds. Je sautais d’un pays à un autre sans compter les heures de vol pour rencontrer mes équipes ou les clients et tisser des liens de confiance, mettant en avant nos équipes, nos solutions, nos produits et notre service partout dans le monde.
CR. Ta réputation de leader a trouvé à s'illustrer ?
Oui c'est ma passion, je l'ai dit au début de notre entretien. Mes directeurs pays ont appris à travailler ensemble et à s’entre-aider. Nous sommes devenus « the Latin American Team » et beaucoup dans les équipes nord-américaines enviaient notre fonctionnement et notre enthousiasme. Ils ont su mettre de côté leurs différences culturelles et leur ressentiment vis-à-vis des Etats-Unis. Les Awards des meilleurs vendeurs, managers et autres ont renforcé cette fierté d’appartenance à Orange Business Services Latin America.
CR. Te confronter à de nouvelles cultures professionnelles a dû nécessiter des changements de braquet dans ta façon de manager. Ou bien y-a-t-il un socle, des fondamentaux dans ta pratique managériale ?
Oui, je pense avoir repéré assez tôt ces fondamentaux. Ce serait quelques chose comme : pas d’arrogance, savoir dire je ne sais pas lorsque je ne sais pas, ne pas craindre de faire des vagues si nécessaire, ne pas m'endormir sur mes lauriers et continuer à apprendre, poser les questions sans heurter, être naturelle c'est à dire éviter de jouer des rôles, même si on le fait parfois à son corps défendant... Enfin, écouter, beaucoup, pour se donner le droit de dire.
CR. Il faut être confiante et ne pas douter de son autorité pour tenir une telle attitude, non ?
Je n'ai jamais approfondi la question de mon profil de
personnalité, ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire... Je respecte les
théories là-dessus mais elles ne m'intéressent pas trop. Ce que je peux
dire de ma pratique est probablement évident pour un théoricien du management,
mais je prends le risque d'être banale en étant très concrète.
D'abord je pense que pour motiver ses collaborateurs, il faut être motivé
soi-même, savoir ce qu’on veut, où on va et comment on y va. Mes objectifs
à l’étranger ou pour l’étranger ont toujours été clairs. J'ai besoin que
les gens avec qui je travaille aiment leur job et pour cela je fais en
sorte qu'ils trouvent du « répondant ». C'est un mot un peu vieillot mais
que j'aime bien. Il évoque le rôle de quelqu'un qui les écoute, les conseille
et développe leurs compétences. Ma porte était toujours ouverte, ce n'est
pas une figure de style. Tous ceux qui ont travaillé avec moi pouvaient
venir me voir avec leur problème et au moins deux solutions possibles.
Je posais des questions et nous choisissions ensemble la meilleure solution.
CR. Cela paraît très fluide et m'incite à revenir sur cette histoire d'autorité naturelle...
C'est juste une attitude, pas une recette. Ça ne fonctionne pas toujours. Certains collaborateurs n’arrivent pas à suivre ou ne sont pas à leur place. Il faut savoir leur dire et les réorienter, ce qui veut dire parfois licencier. Lorsque je dois arriver à cet extrême, je les accompagne dans leur recherche d’un autre job ou dans leur souhait de créer leur propre business. Ce fut le cas pour pas mal de personnes. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure sur le doute, je me suis souvent interrogée : est-ce que je ne suis pas trop dure ? Trop émotionnelle ? Douter, quand on est responsable des gens, c'est la moindre des choses.
CR. Ta vie professionnelle donne l'impression d'un shoot permanent. Comment quitte-t-on cette vie ?
Pour moi, ces deux années de contrat étaient mes dernières
années de travail car je désirais absolument partir à la retraite dès
que possible. J’adorais mon job, mes équipes, Rio De Janeiro et nous avions
de bons résultats. Mais je ne voulais pas faire de concession sur ma retraite.
Je préparais naturellement mon successeur car je ne voulais pas que Paris
envoie un « parachuté » qui casserait peut-être les dynamiques de management
et la stratégie que nous avions élaborée pour les trois prochaines années.
Mon boss a fini par accepter mon successeur.
Partir à la retraite sur un dernier succès professionnel, entouré de respect
et même d’affection de ses équipes, détermine sans doute l’état d’esprit
des prochaines années. J’avais plusieurs projets personnels au moment
de partir et deux ans plus tard, j’en ai d’autres : les voyages, toujours,
la transmission du savoir et si possible, l’aide à ceux qui en ont besoin.
Et puis il me reste ces relations humaines avec des hommes et des femmes
culturellement différents mais qui m'étaient si proches en même temps
et qui sont devenus au fil des années des amis.
CR. Tes enfants t'ont suivi dans cette vie. Cela pose la question de l'adaptation
Evidemment ! Le scénario le plus courant dans les familles d'expatriés est : le père travaille, la mère suit et s'occupe des enfants. Mes filles ne manquaient pas de comparer leur situation à celle des enfants côtoyés dans les écoles françaises. Notre modèle était différent, voilà tout. Dans tous les pays où nous avons vécu, il est vrai que la première année était toujours difficile. Puis elles tissaient chaque fois un réseau social infiniment riche et diversifié qu'elles ont d'ailleurs conservé. C'était une vie de non enracinement, faite de rencontres de cultures inconnues, d’amitiés de toutes les couleurs. En grandissant, elles se sont senties privilégiées. Pendant et après leurs études supérieures en France, elles me rejoignaient pour faire des stages dans les entreprises de mes collègues, travailler et perfectionner les langues étrangères. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes autonomes, hyper adaptables, assoiffées d'ailleurs, mais sur un autre mode que moi.
CR. Transmettre, aider... disais-tu tout à l'heure. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes adultes, encore étudiants ou fraîchement sortis de leurs études, qui envisagent de « faire carrière » sur d'autres continents ?
C'est une question qui aurait pu être heureuse, mais qui est douloureuse. Je pense beaucoup à eux ces derniers temps. Avec toute leur intelligence et les ressources intellectuelles qui leur sont données dans une école comme sciences po, comment peuvent-ils se projeter dans le monde après un an de confinement en pointillés, peut-être deux, ou plus ? Leur avenir est incertain alors qu'il était grand ouvert pour moi. Et s'ils parviennent à se mettre à l'abri des dégâts, sanitaires et économiques, causés par les virus, qu'en sera-t-il pour eux de la possibilité de circuler et de travailler sur des continents dont les frontières se ferment au gré des menaces sanitaires, dans des pays gangrenés par le terrorisme, la débâcle écologique, l'insécurité économique... ? C'est un tout autre tableau que celui que je dépeignais au début de notre entretien quand j'évoquais les conquêtes enthousiasmantes des pays pour exister politiquement. Conseils et messages me semblent déplacés, au sens propre du terme. Moi qui ai eu la vie professionnelle que j'espérais, j'aimerais plutôt parler avec eux, savoir où ils en sont de leur sentiment de liberté, de quoi est fait leur engagement, à quelle autre forme d'espoir ils aspirent...
CR. Tu vis au Portugal à présent et tu parlais de voyages tout à l'heure. D'autres projets pour ta vie de retraitée ?
Des voyages bien sûr autant que nos nouveaux modes de vie désormais assujettis à la pandémie nous le permettront. Pour le reste, je ne suis fermée à rien. Récemment, j’ai été approchée par d’anciens collègues reconvertis pour prendre part à des conseils d’administration à l’étranger. Je réfléchis…
Catherine RUMILLAT
Afficher
son courriel
22/02/2021