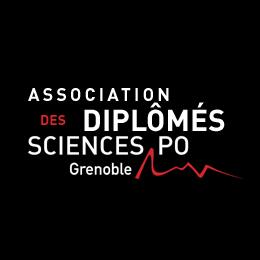Interview de Caroline GADOU (1996 SP), Marraine de la promotion 2024 lors de la remise des diplômes Sciences Po Grenoble du 22 mars 2025
 Margault Lemaire et Gabriel Rieger se sont rendus à Lyon, dans
les bureaux de l’ANACT, où ils ont été accueillis
par sa directrice générale, Caroline Gadou, pour une interview
en exclusivité.
Margault Lemaire et Gabriel Rieger se sont rendus à Lyon, dans
les bureaux de l’ANACT, où ils ont été accueillis
par sa directrice générale, Caroline Gadou, pour une interview
en exclusivité.
Le Cheveu sur la Langue : Vous êtes donc la marraine de la cérémonie d'obtention des diplômes cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que cela représente pour vous ? Que retenez-vous de votre parcours à la Science Po Grenoble ?
Caroline Gadou : Ça a été une belle surprise d'être choisie pour être la marraine de cette année, de cette promo, un honneur aussi et puis une occasion rare et qui va être certainement très chaleureuse de retourner à Sciences Po. Ce sera une occasion de voir comment les étudiants d'aujourd'hui préparent la suite. J'espère par ailleurs, pouvoir leur donner quelques clés par rapport à ce que j'ai pu faire, depuis cette période où j’y étais.
LCL : Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours ?
CG : À Sciences Po, j'ai découvert le monde de l'action publique et des politiques publiques. Ma famille n'étant pas du tout issue de l'administration, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de rejoindre les services administratifs et de me préparer aux différents concours de la fonction publique qui m’intéressaient.
Il m’a ensuite semblé pertinent d'intégrer une classe préparatoire reconnue pour la diversité des débouchés qu’elle offrait. J’ai ainsi eu l'opportunité de rejoindre Sciences Po Paris, où j’ai préparé à la fois les concours du Parlement — Assemblée nationale et Sénat — ainsi que ceux des collectivités territoriales. J’ai donc passé deux ans à Paris à réviser, me préparer et présenter différents concours. J'ai eu la chance d'intégrer l'ENA.
Par la suite, j’ai effectué plusieurs stages : un an en administration territoriale, puis un autre à l’étranger, à Bruxelles, au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.
À ma sortie de l’ENA, je me suis véritablement passionnée pour les questions d’emploi et de formation, en étant rattachée au ministère de l’Emploi. Comme c'est souvent le cas dans un parcours de fonctionnaire, il est possible de changer d’administration au fil des opportunités. J’ai ainsi quitté le ministère de l’Emploi pour rejoindre le ministère de l’Intérieur en tant que sous-préfète. À ce poste, j’ai occupé plusieurs fonctions très différentes, dans des départements et des régions tout aussi variés.
À ce moment-là, j’ai également ressenti l’envie de travailler en collectivité locale. J’ai donc été nommée directrice adjointe en charge des questions d’apprentissage et de formation au Conseil régional du Centre.
Dès le début de mon parcours, peu de temps après Sciences Po, j’ai découvert de grands domaines qui ont structuré mon itinéraire professionnel jusqu’à aujourd’hui. Aussi, je me suis autorisé à aller voir des choses différentes et c’est très enrichissant, ça fait du bien.
LCL : Vous êtes aujourd’hui la directrice générale de l’ANACT, l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail depuis un peu plus d'un an. Pouvez-vous nous décrire vos fonctions, à quoi ressemble une journée type dans votre peau ?
CG : L’ANACT est un établissement public administratif sous tutelle du ministère du Travail. Depuis deux ans, un peu avant mon arrivée, l’agence a connu une transformation majeure avec la fusion des associations régionales qui travaillaient sur le même champ d’action, une restructuration qui est aujourd’hui au cœur de mon activité.
Mon rôle principal est de définir et mettre en œuvre un projet stratégique pour l’établissement et ses 280 agents répartis dans 16 régions métropolitaines et ultramarines, l’objectif étant de créer une culture commune, de fédérer les équipes et de les faire avancer dans une direction cohérente.
Cette mission implique d’abord un travail sur les ressources humaines, puisqu’il s’agit de définir une politique adaptée pour attirer et fidéliser les bons profils, assurer leur formation et leur intégration, mais elle repose aussi sur une gestion budgétaire rigoureuse, car dans un contexte de tension sur les finances publiques, il faut maîtriser les dépenses et rechercher des financements adaptés. Il y a également un enjeu de développement des partenariats et de communication, puisque nous accompagnons les entreprises en développant des outils et des méthodes pour améliorer les conditions de travail, ce qui suppose de collaborer avec divers organismes et de mettre en place une stratégie de communication efficace afin de toucher un maximum d’acteurs. Enfin, il est essentiel d’anticiper les évolutions du monde du travail et de nous positionner sur des enjeux majeurs comme l’intelligence artificielle, la transition écologique, le choc démographique ou encore les nouvelles attentes vis-à-vis du travail, autant de transformations qui doivent être pensées et mises en œuvre de manière cohérente.
En tant que directrice générale, je joue
donc un rôle de chef d’orchestre pour coordonner l’ensemble
de ces actions. Bien que mon travail soit encore très tourné
vers l’interne, j’ai de plus en plus d’échanges
avec des acteurs extérieurs afin de développer des coopérations
et d’approfondir certaines problématiques sectorielles, et
j’essaie également de me déplacer régulièrement
en région pour rencontrer nos équipes locales et mieux comprendre
leurs enjeux.
LCL : Vous avez mentionné un intérêt très
tôt pour la fonction publique, d’où vous vient-il ?
CG : Tout d’abord, il faut replacer cette question dans le contexte de ce qu’était la fonction publique à l’époque où j’étais à Sciences Po dans les années 90. Aujourd’hui, on observe davantage de difficultés pour les différentes fonctions publiques à attirer notamment les jeunes, avec une véritable crise du recrutement, ce qui n’était pas le cas à cette époque.
À ce moment-là, la fonction publique bénéficiait d’une image plus stable et plus attractive, à la fois en raison de l’importance accordée à la sécurité de l’emploi, qui pouvait constituer un facteur d’attractivité pour un certain nombre de personnes, mais aussi parce qu’elle offrait un véritable levier d’action sur la société en permettant de travailler au service de l’État ou des collectivités locales. Cela reste toujours le cas aujourd’hui, mais on perçoit aussi une remise en question du rôle et de la capacité d’action de la puissance publique, qui ne semble plus aussi étendue qu’auparavant.
Ce qui m’a particulièrement attirée à l’époque, c’était justement cette capacité d’agir sur des enjeux majeurs, de contribuer à une action collective ayant un impact réel sur la société, d’améliorer le fonctionnement de certains secteurs économiques, d’influencer des politiques publiques et notamment celles liées à la formation, qui représente un puissant levier d’émancipation. L’idée de permettre aux individus d’évoluer tout au long de leur vie professionnelle, sans être assignés à un métier ou un secteur unique, me semblait particulièrement essentielle.
Il y avait alors une conception de l’action publique plus forte, mieux perçue et mieux reconnue qu’elle ne l’est aujourd’hui, ce qui renforçait le sentiment de participer à un projet collectif au service de la société et constituait une motivation particulièrement mobilisatrice.
LCL : Aujourd'hui on observe une écrasante majorité d’étudiantes sur les bancs de Sciences- Po. Toutefois ces proportions ne se reflètent pas du tout dans les postes de la haute fonction publique, notamment comme celui que vous occupez aujourd'hui. Quelle vision est-ce que vous avez de cela ? Quels conseils donneriez-vous aux femmes souhaitant faire carrière dans la haute fonction publique, comme vous le faites ?
CG : Le plafond de verre et les inégalités persistantes sur les postes à responsabilités restent une réalité, aussi bien dans la haute fonction publique que dans le secteur privé. Toutefois, il est important de noter que les choses progressent. Depuis une dizaine d’années, on observe un véritable volontarisme, avec une prise de conscience et une mobilisation accrue pour favoriser l’accès des femmes à ces fonctions. Celles qui occupent aujourd’hui des postes à haute responsabilité ont d’ailleurs souvent à cœur d’encourager et d’attirer d’autres femmes, notamment les plus jeunes, à les rejoindre.
Ces évolutions sont bel et bien engagées et commencent à produire des effets concrets. Dans la fonction publique, la proportion de femmes aux postes de direction s’accroît, et cette tendance s’observe également dans le monde politique et économique. On rencontre aujourd’hui de plus en plus d’interlocutrices parmi les élus locaux et nationaux, alors qu’il y a encore quelques années, ces fonctions étaient quasi exclusivement occupées par des hommes, qu’il s’agisse de députés, de sénateurs, de conseillers départementaux ou régionaux, ou encore de maires.
Le message que je souhaite adresser aux étudiantes intéressées par ces carrières est avant tout de ne pas avoir peur. Les évolutions en cours ouvrent de nouvelles perspectives, et plus les femmes seront nombreuses à franchir ces portes et à s’entraider, plus ces progrès s’accéléreront.
LCL : Samedi prochain vous allez vous adresser à des jeunes diplômés de Sciences Po Grenoble. Ils quittent le monde académique pour s'insérer dans le monde professionnel. C'est une épreuve que vous avez-vous-même vécu, quels conseils vous leur donneriez pour faciliter cette insertion ?
CG : Ils ont sans doute déjà anticipé cette transition et ont commencé à acquérir des expériences variées, que ce soit à travers des activités associatives ou d’autres formes d’engagement leur permettant de découvrir différents univers professionnels. Ces rencontres et immersions nourrissent leur parcours et constituent une première étape essentielle.
À la sortie de Sciences Po, il est important de garder à l’esprit qu’un parcours professionnel se construit par étapes. Aujourd’hui, les passerelles entre les secteurs sont plus nombreuses que jamais, et il est fort probable que chacun change plusieurs fois de métier et d’univers au cours de sa carrière. Il faut donc se donner le droit d’explorer, d’expérimenter, d’essayer différents domaines avant de trouver celui dans lequel on souhaitera s’investir sur le long terme.
Il ne faut surtout pas négliger les métiers de la fonction publique. Même si, comme je l’évoquais précédemment, ces carrières semblent parfois moins attractives aujourd’hui, elles offrent pourtant des opportunités passionnantes. Face aux grands enjeux sociétaux qui traversent notre pays, nous avons besoin d’administrations locales et nationales solides, portées par des personnes motivées, dotées d’une vision et prêtes à consacrer leur temps et leur énergie au service de l’action publique. La diversité des métiers de la sphère publique en fait un domaine toujours aussi stimulant et porteur de sens.
Enfin, autant que possible, il faut chercher à être sur le terrain, multiplier les allers-retours entre différentes expériences, éviter de s’enfermer trop tôt dans une spécialisation ou une approche unique. Se confronter à la réalité concrète des actions, travailler avec des personnes aux horizons variés permet d’enrichir sa vision et d’acquérir une approche plus large, plus pragmatique et plus convaincante des politiques publiques.
Margault Lemaire et Gabriel Rieger
Afficher
leur courriel
14/03/2025