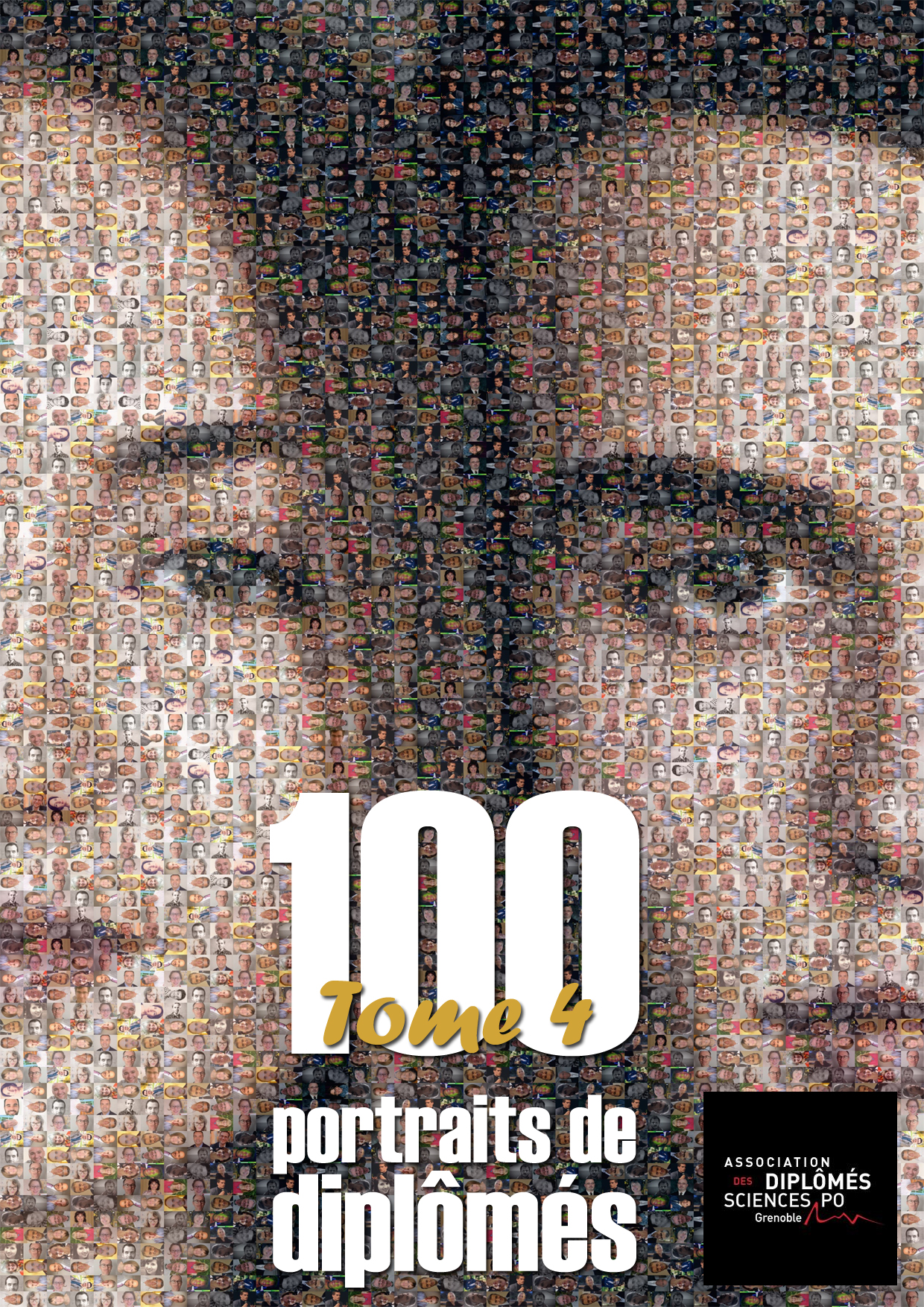Pascale MOSSUZ ép. LYNCH (MST Sc Pol 1984)
 Je
ne suis pas très sûre de ce que je viens faire dans cette collection de
portraits… Mais je suppose que les associations d’anciens diplômés fonctionnent
aussi comme les musées : de temps à autres, il faut bien dépoussiérer
les antiquités entreposées dans les caves ! Dans ce contexte, je remplis
probablement quelques critères : femme (X), formation oubliée (X), vivant
à l’Etranger depuis près de 35 ans (X).
Je
ne suis pas très sûre de ce que je viens faire dans cette collection de
portraits… Mais je suppose que les associations d’anciens diplômés fonctionnent
aussi comme les musées : de temps à autres, il faut bien dépoussiérer
les antiquités entreposées dans les caves ! Dans ce contexte, je remplis
probablement quelques critères : femme (X), formation oubliée (X), vivant
à l’Etranger depuis près de 35 ans (X).
En Terminale littéraire, quelque mois avant le bac, alors qu’une bonne partie de mon entourage pensait que j’allais faire Khâgne et Hypokhâgne, je ne voyais guère autre que Science Po pour satisfaire mes intérêts, qui variaient des affaires étrangères à la littérature, en passant par l’histoire, le commerce international et les voyages de découverte. Le seul « hic » était que je voulais continuer à perfectionner mes langues étrangères (Allemand, Anglais, Espagnol – encore que cette dernière fût un choix stratégique âprement négocié avec mes parents pour pouvoir laisser tomber le Latin…). Puis, lors d’un genre de foire aux carrières organisée par mon lycée, une ancienne camarade de collège nous a introduit, mes deux meilleures copines et moi, à la MST Trilingue avec options Droit ou Science Po ou Science Eco. Et la lumière fût ! Je ne me suis même pas inscrite pour quelque autre formation que ce soit, tant celle-ci me paraissait idéale pour moi. (Ah ! l’insouciance de la jeunesse…)
Pas d’examen d’entrée à Science Po, mais pré-sélection sur dossier scolaire (il n’y avait que 25 places au total pour les 3 options je crois) suivi d’un entretien éliminatoire. Formation sur 4 ans (à l’époque le cursus Sc. P. était de 3 ans – on faisait donc la première année en 2 ans, tout en préparant un DEUG en 2 langues étrangères à Grenoble III). Les 2 dernières années étaient concentrées sur les sciences politiques, avec seulement quelques heures de cours de langues (Thème, version, civilisation) par semaine à Grenoble III. Et pour que la Maitrise soit validée, il y avait 2 stages obligatoires de 6 semaines à 3 mois dans les pays des deux langues étudiées. « Sounds familiar ? », comme dirait l’autre ?
Au bout de ces 4 ans, j’ai obtenu mon diplôme (de justesse, mais sans trop me fatiguer et du premier coup, alors…), de solides connaissances générales, je parlais Anglais et Allemand quasi couramment et surtout, j’avais acquis une méthode et un état d’esprit me permettant de faire face à un bon nombre de situations, professionnelles ou de la vie courante, à l’Etranger ou en France. J’avais également décidé assez tôt dans mes études que le journalisme – qui m’avait tentée au début – n’était plus mon but. J’avais maintenant le tête tournée vers les institutions internationales et un doctorat en politique internationale.
J’ai réussi à me faire admettre à l’IUHEI (maintenant appelé IHEID) à Genève, situé à l’époque dans la villa rose léguée par Mme Barton à la ville de Genève, sur les bords du lac Léman. L’enseignement était bilingue Anglais – Français. Deux années extraordinaires, hors du temps, à côtoyer des diplomates, enfants de dignitaires étrangers, espions probables, réfugiés politiques, à discuter théories, histoires, littératures, coutumes et pratiques de tous les pays en Anglais et en Français, mais aussi en Allemand, en Espagnol ou des bribes d’Italien. Notre bibliothèque était au sous-sol de l’immeuble du GATT voisin. On l’atteignait en traversant le parking du HCR. Quand on voulait des références plus pointues, on montait la colline à la bibliothèque du Palais des Nations. Cette fois, je me traçais un avenir dans la bulle feutrée de la diplomatie internationale.
Et puis, entre la première et la deuxième année à l’IUHEI, mon avenir a pris un autre virage : alors que je passais l’été comme volontaire agricole dans un kibboutz israélien sur le plateau du Golan, j’ai rencontré un bel Australien qui accomplissait le rite de passage de ses compatriotes de notre génération : 2 ans de voyage en Europe et autour sur un visa dit de « Working Holiday », avec base à Londres (à y faire des boulots temporaires pour gagner l’argent nécessaire à explorer l’Europe par petits bouts). J’ai fini mes 2 ans à l’IUHEI, réussi mon examen d’études approfondies de doctorat, mais je n’avais plus envie de passer encore 4 à 5 ans à préparer un doctorat. Je suis donc rentrée à Grenoble chercher du travail et passer des concours administratifs. Mais, m’étant rendue à Londres retrouver mon Australien pour des vacances, j’y suis restée !... J’ai travaillé pendant un an dans la section des ventes en gros de Burberry, située dans leur usine d’origine à Hackney – une banlieue fort peu salubre à l’époque -, à débrouiller les constantes querelles entre représentants de mode européens francophones et les usines de fabrication des collections situées au nord de l’Angleterre. Je me suis aperçue alors que le chapitre des accents locaux britanniques n’avait pas été abordé lors de mon éducation…
C’est alors qu’au mois de septembre, mon bel Australien, ingénieur chimiste spécialiste de flottation, ayant réalisé le score maximum possible du GMAT, a décidé d’aller faire son MBA à l’Université de Nouvelle Galles du Sud (UNSW) à Sydney et m’a demandé de l’accompagner !En novembre, nous sommes retournés en France le temps de nous marier dans le tout petit village de la Drôme où ma famille et moi passions la plupart de nos étés et trois saisons de weekends depuis qu’on avait marché sur la lune ; là encore sous le signe des voyages et des langues : le prêtre était allemand, le jeune marié a du faire une traduction anglaise des Béatitudes juste avant la messe pour qu’il y ait au moins une lecture que ses parents (détournés de leur accompagnement d’un groupe d’étudiants australiens en URSS) puissent comprendre, nos amis anglais parlaient peu de Français et le reste de la famille et des amis venait des quatre coins du quart sud-est de la France et ne parlait pas Anglais !
Malgré cet avant-goût des choses à venir, au mois de janvier 1989, quand je suis descendue du gros 747 de Nippon Airways sur le tarmac de l’aéroport « international » de Brisbane, par 26 degrés de chaleur lourde et humide à 6h du matin pour faire face à des douaniers au fort accent du Queensland, en short, manches courtes, longues chaussettes et chapeaux à large bord, je me suis dit que j’étais peut-être allé trop loin !...
Mais 32 ans après, je suis toujours en Australie ! Perth est notre base depuis plus de 30 ans et nous avons vécu à Sydney (2 fois) et à Melbourne, avec des périodes dans des villes minières au milieu de nulle part : Tom Price (4 ans), dans les Pilbara en Australie occidentale et Labrador City (18 mois) au Labrador au Canada. Côté carrière par contre, les 20 et quelques premières années n’ont pas été très propices à l’établissement de quelque chose de tangible. Mais j’ai acquis des connaissances dans des domaines fort divers, de la gestion des cartons de légumes frais pour une coopérative à la rédaction d’articles d’affaires locales pour un journal francophone de Terre-Neuve, en passant par la vente de feuilles de plastique pour la fabrication d’enseignes commerciales et opératrice au service des factures en retard pour les télécoms australiennes ! J’ai 2 chiffres à avancer pour me justifier : 3 enfants, 12 déménagements !
Ce n’est qu’à la quarantaine, une fois les déménagements terminés, la maison agrandie et tous les enfants dans le système scolaire que j’ai pu entreprendre une carrière à mi-temps, qui a commencée par un travail de relecture et édition d’offres d’emploi placées dans tous les journaux possibles d’Australie. Et finalement, au bout de 18 mois, s’est présentée l’occasion que j’attendais depuis 20 ans : traduction de documents de l’Anglais au Français (et vice-versa) pour une entreprise minière opérant en Afrique de l’Ouest. Rapidement, j’ai fait plus que simplement traduire des contrats : on me demandait de rechercher des décrets obscurs, d’élaborer des lettres, de servir d’interprète dans des coups de téléphone et parfois dans des conférences minières. J’ai participé à la mise en place de suggestions pour des révisions de plusieurs Codes Miniers africains, aidé à l’élaboration de slogans d’entreprise ou de marketing, à débrouiller des revendications obscures (et parfois hilarantes). Et c’est que je fais depuis bientôt 15 ans : j’ai changé plusieurs fois de compagnie minière et de métal (fer, cuivre, or ou bauxite), mais c’est toujours à mi-temps dans des « juniors » australiennes opérant en Afrique francophone. Rapidement, je me suis mise à mon compte (Pascale Lynch Translations), ce qui me permettait d’accepter des traductions supplémentaires en freelance d’une agence de traduction basée à Sydney, en plus des boulots contractuels que j’avais en Australie occidentale. Mais depuis 2015, je fais uniquement du télétravail, après avoir perdu mon emploi contractuel avec une entreprise. Le contact régulier avec d’autres employés d’un même bureau me manque un peu, mais le travail de traductrice est par nature assez solitaire. Et puis je peux me livrer en toute impunité à ma passion primaire, à savoir la chasse aux mots ! La traduction technique (en l’occurrence des termes de l’industrie minière) pose pas mal de casse-têtes en raison de la disparité des approches et de l’innovation selon les pays. Ce qui veut dire que les dictionnaires papier, quoiqu’utiles, ne suffisent pas… Au fil des ans, je suis passée pro dans le balayage des sources internet et les références croisées. Les logiciels de traduction font gagner du temps en termes de temps de frappe (surtout pour moi, qui ne tape toujours qu’avec 6 doigts…) mais il faut constamment relire et corriger ce qu’ils produisent, de manière à rendre un texte cohérent. Beaucoup de gens oublient que ce ne sont que des applications numériques basées sur des statistiques. C’est pourquoi la plupart des traducteurs se constituent leur propres systèmes de références, que ça soit par l’ajout de dictionnaires/glossaires dans nos programmes de traduction ou la construction de fichiers papiers avec photos et commentaires pour capturer les références pointues, spécialisées ou obscures.
Voilà, c’est moi. Je n’ai pas réformé le monde, ni fait de carrière stellaire, mais j’ai vu du pays, appris pas mal de choses, oublié encore plus. J’existe entre deux hémisphères, deux langues et deux cultures et nationalités. Dans ce sens, la formation de MST science po m’a parfaitement préparée à ce destin croisé : car, comme l’a fait remarquer ce bon vieux Charles Darwin, la clé de l’évolution, c’est l’adaptation à son environnement.
Pascale MOSSUZ ép. LYNCH
Afficher
son courriel
10/05/2021