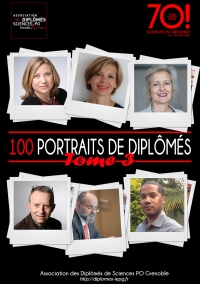Marc
LATHUILLIERE (1992 PO). Artiste, photographe et commissaire d’exposition
indépendant. Dernière exposition : “Le produit France”, avec Michel Houellebecq,
à la Galerie Binôme et au Pavillon Carré de Baudouin, Mois de la photo
à Paris 2014. Dernière publication Musée national, La Martinière,
2014, 216 p,
Marc
LATHUILLIERE (1992 PO). Artiste, photographe et commissaire d’exposition
indépendant. Dernière exposition : “Le produit France”, avec Michel Houellebecq,
à la Galerie Binôme et au Pavillon Carré de Baudouin, Mois de la photo
à Paris 2014. Dernière publication Musée national, La Martinière,
2014, 216 p,
www.lathuilliere.com
 Benoît
DE TREGLODE (1991 PO), Chercheur et directeur du programme Asie de l’Institut
de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM). Auteur de plusieurs
ouvrages sur le Viêt Nam. Dernière publication : « Les enjeux géopolitiques
du Viêt Nam », Hérodote, n°157, 2e trimestre 2015, 215 pages.
Benoît
DE TREGLODE (1991 PO), Chercheur et directeur du programme Asie de l’Institut
de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM). Auteur de plusieurs
ouvrages sur le Viêt Nam. Dernière publication : « Les enjeux géopolitiques
du Viêt Nam », Hérodote, n°157, 2e trimestre 2015, 215 pages.
ML
Nous avons tous deux été formés à l’IEP de Grenoble, où nous avons fait
connaissance. Nous avions en commun une grand attirance pour l’étranger
et la création - plutôt cinéma pour toi, plutôt littérature pour moi –
et une vraie soif d’expériences permettant de croiser les deux domaines.
Au sortir de l’école, comment s’est opéré ton choix ?
BDT
Le choix n’a pas été très facile. En dernière année d’IEPG, je travaillais,
bénévolement, comme programmateur de la cinémathèque de Grenoble et tout
en préparant mon mémoire de recherche sur l’Ethiopie communiste en codirigé
par un enseignant de l’INALCO à Paris. Une fois mon diplôme en poche,
j’hésitais entre ces deux domaines. J’ai choisi de partir à Berlin car
je pensais que j’arriverai mieux à prendre ma décision là-bas. J’avais
découvert cette ville en 1989, alors que j’attendais mes résultats du
concours de l’IEPG. Début octobre, j’étais dans la foule du défilé du
40e anniversaire de la RDA. Un mois plus tard, lorsque le mur tombait,
j’étais en cours à l’IEPG. J’avais adoré l’atmosphère de cette « ville-histoire
» marquée par la Guerre froide. En 1991, je quittais l’IEPG pour la Freie
Universität de Berlin, une année Erasmus pour m’aider à faire un choix.
Le milieu de la production cinéma m’attirait, mais j’adorais également
les voyages, les sciences humaines et mon travail sur l’Ethiopie m’avait
beaucoup plu. Finalement, je n’ai pas réussi à faire mon choix au cours
de cette année allemande. En revanche, le basculement de l’Europe orientale,
l’ancien bloc de l’Est, et la disparition de l’Union soviétique continuait
de me fasciner. Une fois rentré en France, je t’ai proposé Marc de partager
une grande colocation à Paris, dans le quartier de Barbès. Je me suis
inscris en DEA d’histoire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
(EHESS) pour travailler sur le Viêt Nam communiste … et parallèlement,
je rejoignais l’équipe de la petite maison de production Shadows films
dans le XVIIe arrondissement. Ce sont les circonstances qui m’ont finalement
forcé à trancher. Je faisais partie à cette époque de l’une de ces dernières
classes d’âge à devoir faire mon service militaire. J’avais opté pour
un service civil à l’étranger (CSNA) dont la durée était passée en 1992
de 24 à 16 mois. En 1992, mon directeur de recherche avait été nommé directeur
de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO). Et là, les choses se sont
soudain déroulées très vite. Un jeudi matin après son séminaire, il m’a
expliqué qu’il se doutait bien que j’avais une autre activité, mais il
m’a proposé de faire mon CSNA dans le nouveau centre de l’EFEO qui venait
de ré-ouvrir à Hanoi, 33 ans après sa fermeture en1959. Je devais par
contre me décider très vite. Il me donnait quelques jours. L’offre était
trop belle. Dans la semaine, je démissionnais de Shadows films. Six mois
plus tard, je vivais à Hanoi et je commençais mon doctorat à l’EHESS.
Je restais cinéphile, mais j’avais définitivement opté pour la recherche
sur le Viêt Nam. Je me souviens nos premières discussions autour de ton
mémoire de dernière année sur le Yémen, comment as-tu par la suite concilié
tes envies de littérature, d'Asie et tes travaux journalistiques ? Comment
as-tu géré ces différents domaines professionnels ?
ML
Il y a des ressemblances dans nos hésitations. Avec une attirance au début
pour la même zone : la mer Rouge et le Corne de l’Afrique. Peut-être parce
que c’est une Afrique politiquement moins lourde que l’autre, la Françafrique,
tout en ayant une dimension romanesque à travers les figures de Rimbaud,
Monfreid et Nizan. Pendant que tu travaillais sur l’Ethiopie, je suis
moi parti au Yémen, qui venait de se réunifier, ce dont personne ne parlait,
pour les premières recherches de mon mémoire de fin d’études sur ce sujet.
Il m’a pris deux ans, prolongé par un Erasmus à Londres. Au retour, le
balancier est reparti du côté de la littérature, avec un DEA à l’EHESS
sur le rock et le roman américains. Au terme de ce second mémoire, qui
nous a vu nous retrouver à Paris, le choix a peut-être été plutôt économique.
On ne se décrète pas écrivain. C’est une pratique longue et exigeante.
En attendant d’avoir pondu mon premier roman, j’ai donc choisi le reportage
en free lance : au début politique et économique sur l’Afrique de l’Est
– Erythrée, Ouganda, Soudan... - ensuite dans le voyage, profession qui
a été la mienne jusqu’à récemment, et qui m’a permis de visiter une cinquantaine
de pays. Elle a nourri, bien au-delà de ce que les journaux me demandaient,
une sorte de pratique du monde à la fois anthropologique et comparative.
Tout fait sens, quand on observe une société : la cuisine est une leçon
d’économie, et connaître une langue aide à lire un paysage. J’étais cependant
frustré de ne passer que peu de temps dans les pays où l’on m’envoyait
: j’avais envie d’une plus longue immersion. Par ailleurs, j’étais en
train de devenir un écrivain mort-né – comme tant de journalistes – n’ayant
plus le temps pour une pratique d’écriture de fond. Comme la presse amorçait
alors ce processus de casse que l’on connaît aujourd’hui, j’ai décidé
de relancer les dés : en 1999, je suis parti vivre en Thaïlande, pays
découvert lors d’un reportage, et qui a pour moi été le premier contact
avec la nouvelle Asie, avec ces formes sociétales en évolution rapide
qui depuis m’ont toujours fascinées. Le projet était d’y écrire un premier
roman, et de m’initier à une nouvelle culture. Lorsque je suis rentré
en France, même si le roman, qui m’a pris encore deux ans, n’a pas été
publié, le choix était fait : ça serait la création, le journalisme ne
devant être qu’alimentaire. L’Asie, où je savais que je retournerais,
serait après l’Afrique le continent de ce nouveau cap. Bien sur je savais
que ce parcours non linéaire ne serait pas sans risque, et que dans ma
société de naissance, la France, si cloisonnée, il serait difficile à
défendre. Bien que tu sois resté dans un cadre plus institutionnel, j’ai
cru comprendre que c’était aussi ton cas.
BDT
C’est vrai. Si je me suis tourné vers l’IEPG, où je suis entré en accès
direct, c’est que je vivais mes études d’histoire à l’université un peu
comme un enfermement. J’aimais l’histoire, mais l’IEPG m’apparaissait
comme beaucoup plus ouvert sur le monde. Peut-être que j’avais déjà en
tête à l’époque que les études en France ne préparent pas tant à un travail
en particulier qu’à une aptitude à en trouver. Après mes 4 années à Hanoi,
mon doctorat soutenu, je voulais continuer la recherche mais l’université
ne me tentait pas suffisamment. J’avais besoin d’action. Alors, parallèlement
à mon post-doc à Sciences Po-Paris, j’ai collaboré à l’équipe Asie de
la Délégation aux Affaires stratégiques du ministère de la Défense. J’ai
ainsi jonglé pendant quelques années entre mes publications universitaires
sur le Viêt Nam et la rédaction de notes politiques sur l’Asie. J’étais
souvent en déplacement, et je commençais déjà comme toi Marc à regretter
le cloisonnement de notre système. J’enviais mes collègues américains
dont la carrière alternait entre l’université, séjours en think tanks
et des postes à l’étranger en ambassades. La complémentarité m’apparaissait
pourtant évidente entre ces fonctions. Mais comme tu l’expliques, il est
toujours difficile d’avoir un parcours hors norme en France, et plus encore
dans l’administration ! J’étais pourtant bel et bien décidé à courir le
risque. Bien heureusement dans une vie professionnelle, on a parfois la
chance de croiser des personnalités prêtes à vous faire confiance. Et
c’est ainsi qu’un jour, on m’a proposé de partir en poste comme Attaché
d’ambassade au Japon pour m’occuper de coopération universitaire. Je ne
rêvais de toute façon que d’une chose à l’époque, c’était de repartir
vivre en Asie. Tokyo fut un véritable choc. Mon travail dans une grosse
ambassade en Asie m’a beaucoup appris … et m’a conduit par la suite à
diriger un institut de recherche du ministère des Affaires étrangères
à Bangkok, l’IRASEC (Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine).
Je retrouvais ma zone de prédilection, l’Asie du Sud-Est, et une fonction
à la croisée de l’universitaire et du politique. Je n’avais pas cessé
de publier sur le Viêt Nam. Une traduction en anglais de ma thèse venait
de sortir chez NUS Press. Avec ce nouveau poste, je découvrais le reste
de cette région fabuleuse, sa diversité et son dynamisme. Je sais que
nombreux collègues ont encore un peu de mal aujourd’hui à accepter ces
réguliers aller/retour. Ils préféreraient que je choisisse clairement
mon camp. On aime beaucoup trop coller des étiquettes en France. L’idée
d’une carrière à vie sur le (seul) principe de l’ancienneté continue de
me gêner. Je n’aime pas beaucoup les zones d’assignation. Lorsqu’il a
fallu que je rentre en France, c’est ainsi que sans hésitation, j’ai accepté
de prendre en charge le département Asie de l’Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire (IRSEM), un centre de recherche qui dépend du ministère
de la Défense. C’est amusant Marc mais je crois que nous avons toujours
partagé ce besoin de flexibilité, et cela dès nos années à l’IEPG. Sinon
comment pourrais-tu expliquer ton basculement vers l’art après le journalisme
?
ML
C’est une question de grille de lecture, ce terme si associé à notre formation,
mais dont il faut se méfier tant il fait écho au mot prison. S’il faut
des cadres pour appréhender le monde, il est essentiel de les multiplier,
de développer des rapports diverses et empathiques avec les cultures autres.
Les enseignements à l’IEPG m’ont donné plusieurs grilles, et surtout les
outils conceptuels pour en comprendre de nouvelles et m’en créer par moi-même.
Cet outillage m’a assez vite révélé les limites du journalisme, qui délivre
du monde une vision largement formatée. Surtout dans le reportage de voyage,
où j’assistais les photographes dans la production de stéréotypes ethnocentristes.
Il fallait donc une nouvelle grille et que j’en sois l’auteur. Cette dernière
mue dans mon parcours, c’est un pays, la Corée du Sud, qui l’a provoquée.
Je suis parti là-bas en 2003 pour un contrat d’un an au service français
de Radio Corée Internationale, mission destinée à me permettre de financer
l’écriture de mon second roman. Le choc culturel fut d’une telle force
que ma réaction a été non verbale : elle est passée par une série photo
faite en traversant le pays en scooter 125. Publiée et exposée sur place,
à ma grande surprise – je l’avais conçue comme un jeu personnel – elle
a fait basculer mon parcours vers les arts visuels.
Au retour à Paris, le choc culturel s’est inversé : j’ai réalisé, après l’Asie, à quel point la société française était sclérosée, arc-boutée sur la conservation de ses patrimoines. Cette compréhension est à l’origine de « Musée national », une vaste série de portraits de Français portant un même masque, développée depuis plus de dix ans, en parallèle à d’autres projets à l’étranger : constat sociologique, elle doit beaucoup à la formation bourdieusienne reçue à l’IEPG. Reste que personne, professionnellement, ne m’attendait sur ce registre : je n’avais pas fait d’école d’art, je n’avais pas au début les codes conceptuels et esthétiques par lesquels le marché et l’institution filtrent ceux qui auront accès à la reconnaissance. Il a donc fallu beaucoup d’abnégation, passer par la fenêtre quand, souvent, les portes restaient fermées. Mais aussi croiser de belles individualités, comme Edouard Mornaud, qui m’a invité pour une résidence importante au Centre Intermondes à La Rochelle. Plus récemment, la rencontre avec Michel Houellebecq, qui a écrit sur « Musée national » un texte critique, a été déterminante. Elle a permis l’an dernier la publication de la série aux éditions de La Martinière, et une double exposition dans le Mois de la photo, appelée « Le produit France » qui m’a apporté beaucoup de visibilité : d’un côté j’ai été commissaire de la première grande exposition de photos sur la France de Michel, de l’autre il soutenait par son texte celle de mes clichés à la Galerie Binôme, qui me représente, avec une reprise en affiches Gare d’Austerlitz dans le cadre d’un partenariat avec Gares & Connexions SNCF. Pour conclure sur nos positions actuelles, comment vois-tu l’apport de l’IEPG dans celle qui est la tienne?
BDT
Ce qui me reste de l’IEPG, c’est d’abord le souvenir d’une école qui m’a
donné la liberté d’oser et le goût de la curiosité. Je n’avais jamais
imaginé devenir un spécialiste de l’Asie, et du Viêt Nam en particulier,
de la manière dont je l’ai réalisé. Si j’étais resté à l’université, mon
chemin aurait été tout tracé … au sein de l’université. L’IEPG m’a donné
le courage de tracer ma propre voie. Aujourd’hui lorsque je travaille
avec des jeunes diplômés (étudiants, stagiaires), je leur demande aussi
de me faire découvrir leurs propres territoires. Les parcours trop tracés
ne m’intéressent pas beaucoup, ils ne mettent pas en avant des personnalités
très attrayantes.
ML
C’est un peu pareil pour les étudiants juste sortis des écoles d’art ou
de photographie, je leur conseille de travailler d’abord sur leur vie.
En ce qui me concerne, ma vision très sociopolitique de la réalité doit
beaucoup à l’IEPG. Musée national est ainsi une série qui a une dimension
d’interpellation, dans le champ artistique mais aussi dans le champ sociétal.
C’est pour cela qu’à partir de l’an prochain elle va partir en tour de
France, comme en campagne, avec différents lieux d’exposition dont les
plus importants sont Le creux de l’enfer, le centre d’art de Thiers, en
2017, et dans la foulée la participation à une rétrospective sur le territoire
français à la BNF, qui a acquis des tirages. Par ailleurs, mes derniers
travaux, théoriques et plastiques, développent une critique de la photographie
de territoire dans son lien avec les pouvoirs politiques qui la commandite.
Il s’agit donc bien de maîtriser le politique, pour mieux s’en affranchir.
Marc Lathuillière / Benoît de Tréglodé
05/01/2016